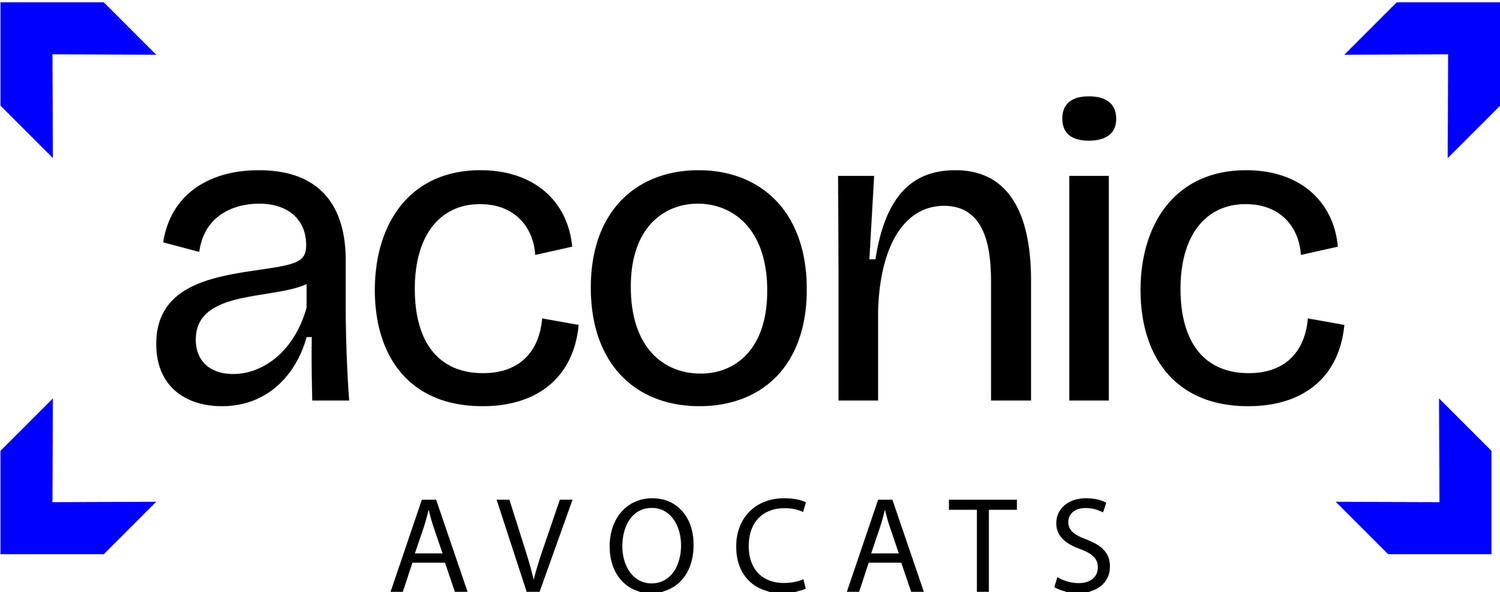La CJUE confirme la nécessité d’obtenir le consentement des artistes-interprètes, même employés sous statut de droit administratif, dans le cadre d’une cession de leurs droits voisins
En 2021, un arrêté royal belge a organisé la gestion des droits voisins des musiciens de l’Orchestre national de Belgique (ONB). Il prévoyait que les musiciens, en contrepartie d’allocations compensatoires, cédaient automatiquement à l’ONB l’ensemble de leurs droits voisins, incluant les droits de reproduction, de communication au public et de distribution, sur les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au sein de cette institution, et ce pour l’ensemble de la durée de protection desdits droits et pour le monde entier.
Contestant la légalité de ce dispositif, plusieurs musiciens ont saisi le Conseil d’État en soutenant que cette cession contrevenait au droit de l’Union européenne, notamment aux exigences des directives 2001/29, 2006/115 et 2019/790 qui organisent les régimes de cession des droits des artistes-interprètes. C’est dans ce contexte que le Conseil d’État belge a soumis à la Cour de justice de l’Union européenne une questions préjudicielles afin de déterminer si la directive susvisée s’opposait à la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ; question à laquelle la juridiction répond par l’affirmative.
Elle explique en effet que ne sont pas exclues de la catégorie des “artistes interprètes” les personnes employées sous statut du droit administratif avant de conclure que les directives susvisées s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit la cession, par la voie réglementaire, aux fins d’une exploitation par l’employeur, des droits voisins d’artistes interprètes ou exécutants engagés sous statut de droit administratif, pour les prestations réalisées dans le cadre de leur mission au service de cet employeur, en l’absence de consentement préalable de ces derniers.
Cour de Justice de l’Union européenne, 1ère chambre, 6 mars 2025, affaire C-575/23